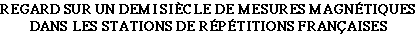
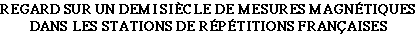
Les mesures ont aussi leur importances pour d'autres applications. Par exemple: les variations rapides du champ sont générées par l'activité solaire et son interaction avec l'environnement terrestre. Les grands orages magnétiques peuvent perturber le fonctionnement des satellites, les systèmes de communication, les réseaux de transmission électrique, etc… [Campbell, 1997]. Le géomagnétisme fournit aussi un moyen exceptionnel pour l'exploration du noyau terrestre, ce noyau est surtout composé de fer en fusion, et c'est à cet endroit que le champ magnétique est généré. Les mesures de champ peuvent aussi permettent une approche fine pour localiser des gisements minéraux et, par leur utilisation, rentabiliser la prospection pétrolière.
Comprendre le comportement du champ magnétique dans le repère spatio-temporel revêt une grande importance [Courtillot et Le Mouël, 1988], et la France a une longue expérience dans le domaine des mesures magnétiques systématiques. (Les auteurs, proposent un film sur le champ magnétique en France.)
En l'an 1541, Künster Bellarmatus a été le premier à déterminer la déclinaison magnétique à Paris: +7° Est (elle a atteint une valeur maximum de +11,5° Est en 1580 et une valeur minimum de -22,5° Ouest en 1814; voir l'article d'Alexandrescu et al. [1996]). En 1667, l'Académie des Sciences créa officiellement l'observatoire de Paris, cet observatoire fit régulièrement des déterminations de déclinaison puis, avec les progrès de la technologie au cours du 18eme siècle, commença à faire des mesures d'inclination. En 1883, le gouvernement Français établit un observatoire magnétique permanent à St. Maur des fossés (10 km à l'Est de Paris); en 1901 cet observatoire fut déplacé au Val Joyeux, toujours en région parisienne, et en 1935 à sa localisation actuelle à Chambon la Forêt, environ 100 km au Sud de Paris, dans le Loiret. A Chambon la Forêt les trois composantes (H, D, Z) du champ magnétique, ainsi que le vecteur champ total (F) sont enregistrés chaque minute, à l'aide de trois ensembles différents (magnétomètres à vanne de flux et magnétomètres à effet overhauser.)
Premier Réseau en 1885
Bien que l'observatoire permanent dispose des données en continu cela ne représente qu'un seul site, il est nécessaire d'avoir d'autres stations pour représenter les variations dans l'espace. Pour cette raison, en 1885 Th. Moureaux [1886] démarra le premier réseau de 80 stations, qui s'épanouit jusqu'à 617 stations en 1898. Les données acquises à cette époque conduisirent à la première carte d'isogones de la France, cette carte n'a pas considérablement changé depuis (Figure 1a).
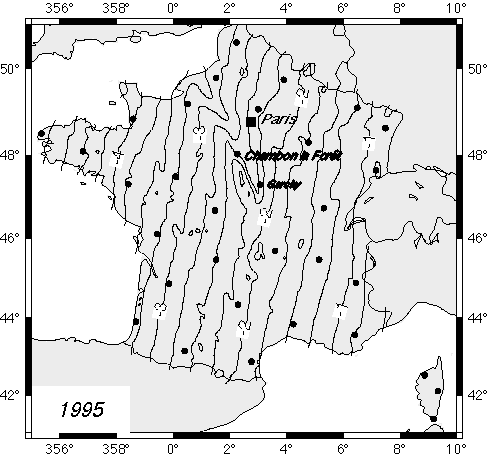
Figure 1a. Localisation
des stations Françaises de répétion (ronds noirs).
Les lignes de déclinaison constante en 1995 (valeurs en degrés)
sont indiquées. On remarque l'anomalie magnétique du
bassin de Paris.
L'Institut de Physique du Globe de Paris a été crée en 1921 et a été chargé des observations régulières relatives au Magnétisme Terrestre. Entre 1921 et 1927, le nombre de stations du réseau a crû jusqu'à 1328. Avec la carte d'anomalies de champ crustal bien établie [Mathias et Maurain, 1929], une couverture aussi dense n'était plus nécessaire. Le réseau Français moderne était créé en 1947 avec 13 stations [Selzer et Thellier, 1949]. Aujourd'hui il est constitué de 33 stations (Figure 1a) [Gilbert, 1992] qui sont occupées une fois tous les cinq ans. Les stations sont dans des endroits isolés, tels que les bords de vignobles (l'un prés de Saint Emilion est d'un intérêt particulier!), avec une distance d'environ 100 km entre elles, et sont protégées par la gendarmerie.
En France, une station magnétique est repérée par un système formé de deux éléments, en surface le point est matérialisé par une borne en roche locale en granite ou calcaire de 1,25 m de longueur et de 0,3 m de diamètre, et dépassant du sol d'environ 0,3 m à l'aplomb de laquelle un cylindre de bronze a été enterré à environ 1,7 m. Le cylindre de bronze est utilisé pour retrouver le site dans le cas où la borne a été volée ou détruite. Pour la mesure nous installons un trépied au-dessus de la borne en centrant le théodolite sur le X gravé dans la pierre à cet effet. On effectue alors plusieurs visée sur les repères prévus a fin de confirmer la position du théodolite et d’établir la direction du Nord vrai. Ces repères sont en général constitués par des croix au-dessus des clochers d'églises ou par des antennes.
On connecte une sonde DI-flux [Gilbert, 1992] au théodolite pour mesurer la déclinaison (D) et l'inclinaison (I). Cette sonde est reliée à un coffret de mesure électronique autonome. On effectue une prospection de l'intensité du champ total (F) sur une surface d'environ 100 m2 autour du point de mesure. Cette prospection est faite à l’aide d’un magnétomètre à précession de protons afin de vérifier qu’il n’y a eut aucun changement significatif apporté à l'environnement magnétique depuis l'occupation précédente. Le magnétomètre à précession de protons continue à mesurer F durant les mesures de D et I. Une technique appelée <<méthode des résidus>> est utilisée pour mesurer le champ magnétique [Newitt et al., 1996]. Les mesures (six au total) sont, faites durant 1 ou 2 jours. Ces mesures sont effectuées à l'aube ou au crépuscule, car l'amplitude de la variation du champ magnétique est maximum pendant le jour (elle culmine autour du midi local); cette variation est due aux sources ionosphérique.
Les éléments du champ magnétique (D, I et F) mesurés aux stations de répétitions sont ramenées aux repères de l'observatoire de Chambon la Forêt, en se basant sur l’hypothèse que les variations transitoires du champ magnétique sont identiques entre la station et l'observatoire. Cette supposition est valable pour des distances inférieures à 400 Km. On peut aussi utiliser les données des observatoires frontaliers. Pour pouvoir comparer les données des stations de répétition avec les valeurs annuelles de l'observatoire de référence, les observations de champ doivent être effectuées en même temps (normalement le premier juillet de l'année en cours).
Dernière Campagne de Mesures
La dernière campagne de mesures du réseau Français a eut lieu au cours de l'été de 1997, c’est à dire un demi siècle après le début du réseau "moderne" de stations de répétitions. Les données ont été réduites à la date 1997,5 avec une incertitude absolue < 5 nT pour chaque élément. Ces données ont été ajoutées à la base de données existante. Nous avons interpolé l'ensemble de cette base afin d’obtenir 20 valeurs par an dans la série de 50 ans dont nous disposions. Nous avons ainsi obtenu des images pour chaque élément, images qui nous ont permis de construire trois films animés ( D, I, et F).
Le Figure 1b montre les trois éléments du champ pour les années 1948, 1974 et 1997. La déclinaison a varié d’environ 5,5° durant les 50 dernières années. Bien que la France ait eu des déclinaisons négatives jusqu’à présent; des déclinaisons positives ont été mesurées pour la première fois en Corse durant la dernière campagne. Paris verra une déclinaison de 0° en l'an 2015 si le taux de variation des 20 années précédentes reste constant. L'addition d'une station près de Garchy, ~200 Km au Sud de Paris, en 1958 souligne l'anomalie magnétique du bassin Parisien (Figure 1a). On constate une inflexion brutale des lignes du champ après 1958, mais pas avant. L'inclinaison a varié seulement d’environ 1° durant la même période. Il est intéressant de noter que la valeur de l’inclinaison a diminué en fonction du temps et de la latitude jusqu'en 1987, depuis elle a crû légèrement jusqu'en 1992, et qu'elle diminue depuis cette date. La direction des valeurs d’égale inclinaison a évoluée durant cet intervalle de temps en relation avec la latitude, l’inclinaison est passée d’une direction sud-ouest nord-est à une direction sud-est nord-ouest.

Figure 1b. Cartes
de declinaison (D; en degrés), inclinaison (I; en degrés),
et intensité total (F; en nT) pour les années 1948,
1974 et 1997.
L'intensité du champ montre aussi des changements significatifs au cours des 50 dernières années. Les valeurs de F se sont accrues de plus de 1000 nT (2%) et le taux de variation n'a pas été constant. Pour F nous constatons une variation de pente analogue à celle de I. De plus, comme pour D, nous constatons une déviation des lignes iso-intensité depuis l'installation de la station de Garchy. Pendant le 50 dernières années, les taux de variation n'ont pas été constants. Les données de Chambon la Forêt ont été cruciales pour la découverte d’une accélération au cours des années 60 connue maintenant sous le nom de "jerk géomagnétique" [Courtillot et al., 1978].
Nous préparons actuellement un film animé (voir ci-dessous) pour les étudiants du niveau du bac. Ce film décrira les changements du champ magnétique terrestre en France durant les 50 années précédentes. Le film inclura une description générale du champ magnétique terrestre ainsi que les méthodes de mesure. Les personnes qui ont contribuées aux mesures des stations de répétitions sont B. Clavé de Otaola, E. Le Borgne, B. Leprêtre, L. Parmentier, G. Petiau, J.C. Rossignol, R. Scheib-Gluntz, E. Seltzer, E. Thellier et les auteurs (Mioara Alexandrescu, Stuart Gilder, Vincent Courtillot, Jean Louis Le Mouël et Daniel Gilbert). Les dessins ont été créés à l'aide du logiciel GMT écrit par P. Wessel et S. Smith.
References
Alexandrescu, M., V. Courtillot et J.L. Le Mouël, Geomagnetic field
direction in Paris since the mid-sixteenth century, Phys. Earth Planet.
Int., 98, 321-360, 1996.
Campbell, W.H., Introduction to Geomagnetic Fields, 290 pp., Cambridge
University Press, Cambridge, 1997.
Courtillot, V., J. Decruix et J.L. Le Mouël, Sur une accélération
récente de la variation séculaire du champ magnétique
terrestre, C.R. Acad. Sci.
Paris Ser. D, 287, 1095-1098, 1978.
Courtillot, V. et J.L. Le Mouël, Time variations of the Earth's
magnetic field: from daily to secular, Ann. Rev. Earth Planet. Sci., 16,
389-476, 1988.
Gilbert, D., Magnétisme terrestre: campagne de mesures de répétition
de la France: 1992, BCMT Paris Bull., 8, 7-44, 1992.
Mathias, E et C. Maurain, Nouveau réseau magnétique de
la France (au 1er janvier 1924), Annales de l'Institut de physique du globe
de l'Université de Paris et du Bureau central de magnétisme
terrestre, t.VIII, Les Presses Universitaires de France, Paris, 37-62,
1929.
Moureaux, Th., Détermination des éléments magnétiques
en France. Nouvelles cartes magnétiques. Annales du
Bureau central météorologique de France, Année 1884,
I., Études des orages en France et Mémoires divers, B55 to
B226, Gauthier-Villars, Paris, 1886.
Newitt, L.R., C.E. Burton et J. Bitterly, Guide for Magnetic Repeat
Station Surveys, 112 pp., International Association of Geomagnetism and
Aeronomy, Boulder, 1996.
Selzer E et Thellier E., Établissement d'un réseau magnétique
de répétition en France Métropolitaine. Première
série de mesures en ces stations, rapportées à l'époque
1948.0, Annales de l'Institut de Physique du Globe de l'Université
de Paris et du Bureau Central de Magnétisme Terrestre., t XXIV,
83-94. Les Presses Universitaires de France, Paris, 1949.
Déclinaison (D) du champ magnétique en France de 1948 à 1997 interpolée tous les deux ans.
Extraire le movie complet (environ 29 Mb)
Extraire le movie complet (environ 18 Mb)